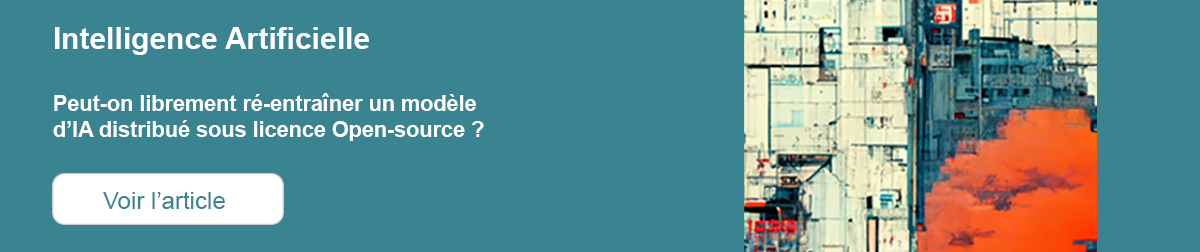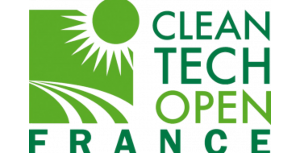La décision G 1/24 de la Grande Chambre de recours, rendue le 18 juin 2025, apporte une clarification attendue de longue date sur un point essentiel du droit des brevets européen : le rôle interprétatif de la description et des dessins dans l’évaluation de la brevetabilité d’une invention. Si cette décision est saluée comme une avancée vers une harmonisation, une analyse plus approfondie révèle une recomposition plus complexe des équilibres jurisprudentiels et institutionnels. L’article soutient que, tout en dissipant des incertitudes anciennes, G 1/24 incarne un glissement plus profond de la logique institutionnelle du droit européen des brevets : d’un formalisme rigide vers une harmonisation pilotée par le juge.
Contexte et questions posées
La décision G 1/24 fait suite à la décision intermédiaire T 0439/22 de la Chambre technique 3.2.01, portant sur un brevet européen détenu par Philip Morris Products S.A. relatif à un article générateur d’aérosol chauffé. Un élément central de la revendication 1 était l’expression « feuille plissée ». L’opposante, Yunnan Tobacco International Co., Ltd., soutenait que l’interprétation de ce terme à la lumière de la description en élargissait la portée au point de lui faire perdre sa nouveauté par rapport à l’état de la technique D1.
Constatant une divergence dans la jurisprudence quant à la possibilité — ou à l’obligation — d’utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications dans le cadre de l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive, la Chambre a saisi la Grande Chambre de trois questions de droit :
- Question 1 : L’article 69(1), deuxième phrase, CBE et l’article 1er du Protocole sur l’interprétation de l’article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l’interprétation des revendications dans le cadre de l’évaluation de la brevetabilité selon les articles 52 à 57 CBE ?
- Question 2 : Peut-on consulter la description et les figures pour interpréter les revendications dans l’évaluation de la brevetabilité ? Et si oui, cela peut-il être fait de manière générale ou seulement si le professionnel du secteur trouve une revendication peu claire ou ambiguë lorsqu’elle est lue isolément ?
- Question 3 : Peut-on écarter une définition ou une information équivalente explicitement donnée dans la description à propos d’un terme utilisé dans les revendications lors de leur interprétation en matière de brevetabilité ? Et si oui, à quelles conditions ?
La Grande Chambre a jugé la question 3 irrecevable, car couverte par la question 2. En revanche, elle a pleinement répondu aux deux premières, apportant un éclairage doctrinal important. Elle a en particulier statué que :
« Les revendications constituent le point de départ et la base de l’évaluation de la brevetabilité d’une invention selon les articles 52 à 57 CBE. La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications dans cette évaluation, et non uniquement si la revendication paraît peu claire ou ambiguë lorsqu’elle est lue isolément. »
Mais la portée de cette décision dépasse largement l’affaire en cause. Elle marque un réalignement de la pratique de l’OEB, remettant en cause les postulats classiques sur les sources du droit et les principes d’interprétation.
L’absence de base légale claire pour l’interprétation des revendications selon la CBE
Au cœur de G 1/24 se trouve un constat saisissant : la Convention sur le brevet européen (CBE) ne fournit pas de fondement juridique pleinement satisfaisant pour l’interprétation des revendications dans l’évaluation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57. La chambre à l’origine du renvoi notait une jurisprudence divergente : certaines décisions invoquaient l’article 69 CBE et son protocole, d’autres l’article 84 CBE, et de nombreuses décisions ne mentionnaient aucune base légale.
La Grande Chambre affirme :
« Ni l’article 69 CBE et son protocole, ni l’article 84 CBE ne fournissent de fondement entièrement satisfaisant à l’interprétation des revendications en matière de brevetabilité » (G 1/24, point 6).
L’article 69, avec son protocole, est historiquement lié aux litiges en contrefaçon devant les juridictions nationales, et non aux procédures d’examen ou d’opposition devant l’OEB. Sa place au Chapitre III de la CBE, intitulé « Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen », le confirme. L’article 84, quant à lui, énonce simplement des exigences formelles et ne guide pas l’interprétation :
« Il s’agit uniquement d’une instruction au rédacteur des revendications et à l’OEB pour vérifier si les revendications répondent à cet objectif » (G 1/24, point 8).
Ce vide juridique n’est pas comblé par la loi, mais par la reconnaissance de la pratique jurisprudentielle. En s’appuyant sur la jurisprudence — malgré ses contradictions — la Grande Chambre affirme que la pratique judiciaire constitue une source autonome du droit. Elle entérine ainsi une conception du droit des brevets européens non seulement fondée sur les textes, mais aussi façonnée par le juge — brouillant la frontière entre interprétation et législation.
Harmonisation judiciaire et alignement institutionnel
Ce rééquilibrage jurisprudentiel ne se produit pas en vase clos. G 1/24 participe à un mouvement plus large d’alignement entre les institutions européennes de la propriété industrielle.
La Grande Chambre ne se contente pas de trancher une divergence doctrinale : elle aligne explicitement la pratique de l’OEB avec celle des juridictions nationales et de la JUB (Jurisdiction unifiée du brevet). Elle rejette la jurisprudence limitant la consultation de la description aux cas d’ambiguïté, la jugeant :
« contraire au libellé — et donc aux principes — de l’article 69 CBE. Elle est également contraire à la pratique des juridictions nationales des États membres de la CBE et à celle de la JUB » (G 1/24, point 15).
Et d’ajouter :
« Il serait très peu attrayant que l’OEB adopte sciemment une pratique opposée à celle des juridictions qui statuent ultérieurement sur les brevets qu’il délivre » (G 1/24, point 16).
La Grande Chambre cite ainsi avec approbation la décision de la Cour d’appel de la JUB dans NanoString Technologies v 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023), qui insiste sur la nécessité de lire les revendications à la lumière de l’ensemble de la divulgation, même en l’absence d’ambiguïté. Ce modèle émergent de coordination jurisprudentielle, en dehors de toute hiérarchie formelle, confirme une dynamique d’intégration européenne du droit des brevets.
De la primauté des revendications à une interprétation contextuelle
Enfin, G 1/24 consacre une rupture avec le principe de primauté des revendications. La décision de renvoi T 0439/22 soulignait déjà cette tension : entre une lecture autonome des revendications et une approche contextualisée fondée sur la description.
La Grande Chambre tranche :
« La description et les dessins sont toujours consultés pour interpréter les revendications, et pas seulement en cas de manque de clarté ou d’ambiguïté » (G 1/24, point 18).
Elle critique la logique opposée, affirmant que :
« Conclure que le libellé d’une revendication est clair et non ambigu constitue déjà un acte d’interprétation, et non un préalable à celui-ci » (G 1/24, point 17).
Ainsi, elle rejette l’approche en deux étapes — d’abord vérifier la clarté, puis consulter la description si nécessaire — au profit d’une méthode unifiée d’interprétation.
Conclusion
La décision G 1/24 constitue un moment charnière de la jurisprudence des brevets en Europe. Elle comble une lacune doctrinale non par la réforme législative, mais par l’autorité de la jurisprudence consolidée. Elle affirme une vision de l’OEB comme acteur intégré dans l’ordre juridique européen. Et surtout, elle redéfinit l’interprétation des revendications comme un exercice nécessairement contextuel.
Mais cette clarification en appelle d’autres : jusqu’où peut aller l’autorité juridictionnelle dans la construction du droit des brevets ? Sommes-nous face à une évolution légitime du droit administratif européen ou à un élargissement excessif du rôle normatif de la Grande Chambre ?
Par Pierre Baudin